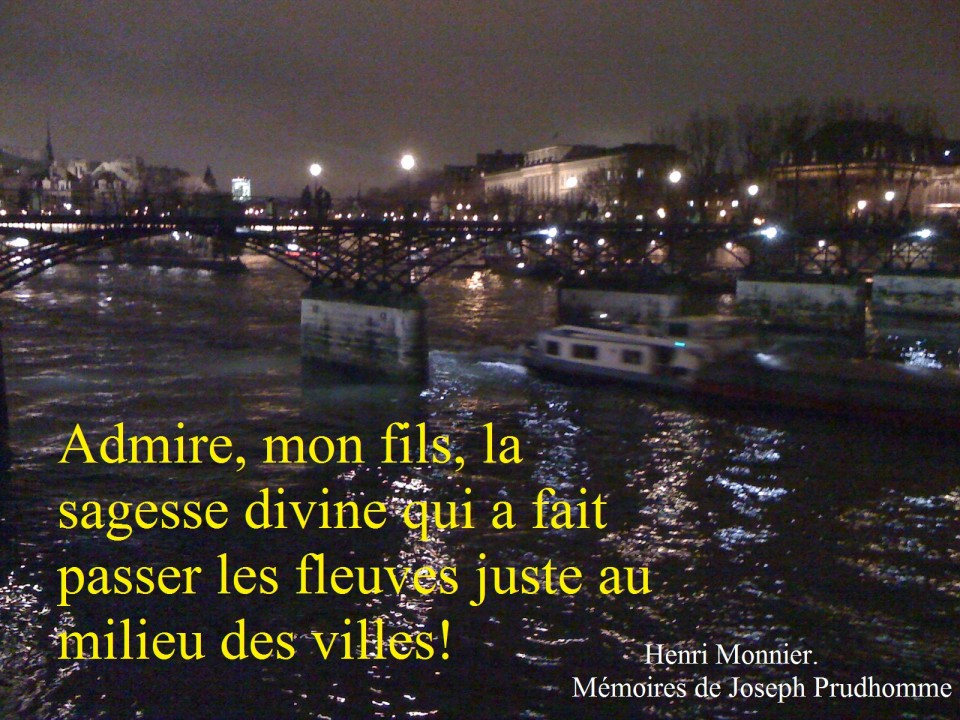Django unchained. Quentin Tarentino.
Paris, Janvier 2013
Ma chère Zoé,
J’ai vu Django Unchained et comme je te l’avais annoncé, je te fais part de mes impressions.
Tout ce que je craignais est arrivé, justifiant à posteriori mes préjugés contre les films de Tarantino. J’ai vu:
— un western tortellini caricaturant les westerns spaghettis
— avec une musique omniprésente, imitant parfois les musiques bon marché des vrais et si épouvantables Django, et d’autres fois les musiques prétentieuses de Ennio Morricone.
— avec un acteur insupportable de cabotinage (le chasseur de prime autrichien), qui avait pourtant sauvé du néant le précédent peu glorieux Inglorious Bastards de Q.Tarantino
— avec un Jammie Fox, admissible car taciturne pendant la majeure partie du film, puis insupportable quand il se met à chausser ses lunettes de soleil de chez Prada
— avec une complaisance grand guignolesque pour les explosions de sang (en l’occurrence, on ne peut pas parler d’écoulements ni d’épanchements)
— avec une reprise de toutes les roublardises et de tous les tics de mise en scène de Sergio Leone (ah! ces regards horripilants et interminables échangés entre adversaires avant la bataille).
Tarantino est un enfant gâté (mais vieillissant) du cinéma, qui a tout vu, sauf les bons films, et caricature les plus mauvais avec des clins d’œil appuyés pour montrer qu’il n’est pas dupe de la bêtise qui s’attache aux sujets qu’il ne traite que pour étaler son habileté et sa culture cinématographique.
Quand Q.T. se décidera-il à tourner un film original, je veux dire un film qui ne soit pas un pastiche, pour nous montrer qu’il sait faire autre chose?
Ou alors, le pastiche n’étant, dit-on, rien d’autre qu’un hommage, quand ce petit génie pastichera-t-il Orson Wells, David Lean, ou Jean Renoir?
Tu as deviné, je n’ai pas vraiment aimé ce film.
Je pardonne encore à Q.T. à cause de son Réservoir Dogs et de sa Pulp Fiction, mais ma patience est à bout.
Du désastre Django, je sauverai pourtant deux scènes:
—le débat qui s’établit entre lyncheurs masqués sur la qualité des sacs aménagés par l’épouse de l’un d’entre eux, et sur ce qu’il convient d’en faire pour la suite de l’opération
—la très longue discussion entre l’éleveur de Mandingos dans sa salle à manger et le chasseur de primes autrichien, dans laquelle Leonardo de C. montre encore une fois tout ce qu’il sait faire.
Sans rancune.
Philippe
P.S. Ça m’a bien détendu d’écrire cette diatribe.