Critique aisée n°113
Les Heures Sombres (Darkest Hours)
Joe Wright – 2017
Gary Oldman, Kristin Scott-Thomas
Tout le film de déroule entre le 8 mai et le 4 juin 1940, quatre semaines seulement. A ceux, de plus en plus nombreux, qui ont la mémoire courte, rappelons brièvement ce qui se passait à l’époque.
Mai 1940. La « drôle de guerre » durait depuis septembre 1939.
Pour satisfaire l’opposition travailliste, Winston Churchill, partisan d’une attitude ferme contre l’Allemagne nazie avait été nommé Premier Lord de l’Amirauté par Neville Chamberlain, premier ministre assez enclin à la négociation avec Hitler.
Le 8 mai, date à laquelle commence le film, Chamberlain est vivement critiqué par les travaillistes pour n’avoir pas préparé le pays à la guerre.
Le 10 mai 40, l’Allemagne envahit les Pays-Bas et la Belgique. Chamberlain doit démissionner et Winston est nommé premier ministre par le roi George VI.
 Pendant ces quatre semaines cruciales, le film nous montrera les colères, les cigares, les hésitations, les cognacs, les doutes, les combats de Churchill pour amener son pays à abandonner toute idée de négociation et, malgré l’encerclement de son armée à Dunkerque, à entrer de toutes ses forces dans la guerre.
Pendant ces quatre semaines cruciales, le film nous montrera les colères, les cigares, les hésitations, les cognacs, les doutes, les combats de Churchill pour amener son pays à abandonner toute idée de négociation et, malgré l’encerclement de son armée à Dunkerque, à entrer de toutes ses forces dans la guerre.
On verra Winston appeler à l’aide Roosevelt, encore isolationniste, sans succès. On le verra frappé de stupeur devant Paul Reynaud, Président du Conseil, défait, lui déclarant que les armées françaises sont en déroute et qu’il n’y a pas de plan de contre-attaque, on le verra pleurer de découragement sur l’épaule de sa femme Clémentine, aimante et spirituelle. On le verra aussi amorcer une amitié durable avec Georges VI (le Roi dont, grâce au cinéma, l’histoire ne retiendra malheureusement que le fait qu’il était bègue), bousculer Attlee, chef du parti Travailliste, (un mouton déguisé en mouton, disait Churchill), s’opposer à Lord Halifax, secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, (Holy Fox selon Winston, Hallali Fax selon Goering), on le verra boire continuellement (Comment pouvez-vous boire dans la journée ? lui demande le roi. Avec de l’entraînement, répond W.C.), fumer sans arrêt, bredouiller, bafouiller, s’emporter, mais aussi dicter, raturer et finalement écrire des discours splendides, et particulièrement le dernier (du film, car il en fera beaucoup d’autres), le discours du 4 juin 1940, discours devant la Chambre qui clôt le film : « … Nous ne fléchirons ni ne faillirons. Nous nous battrons dans les rues, dans les champs, nous nous battrons sur les collines et sur les grèves… », discours sublime et galvaniseur, annonciateur de l’incroyable résistance du pays qui pendant plus d’un an sera le seul à s’opposer à Hitler, et auquel le monde occidental devra d’avoir pu anéantir le nazisme. Mais les heures sombres ne font que commencer, on le sait.
Voilà pour l’histoire, ou plutôt l’Histoire.
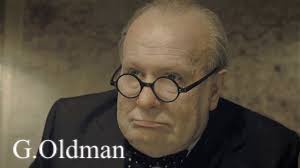 Pour ce qui est du film, j’ai vu une excellente performance de Gary Oldman, qui s’est composé un physique frappant de ressemblance, et une élocution étonnamment hésitante, dont j’ose croire qu’elle est fidèle à la réalité. Très bonne Kristin Scott-Thomas également, toute en distinction et humour britannique, bonne reconstitution aussi de Londres et de la Chambre. Bien, tout ça… Très correct, de bonne tenue, very british.
Pour ce qui est du film, j’ai vu une excellente performance de Gary Oldman, qui s’est composé un physique frappant de ressemblance, et une élocution étonnamment hésitante, dont j’ose croire qu’elle est fidèle à la réalité. Très bonne Kristin Scott-Thomas également, toute en distinction et humour britannique, bonne reconstitution aussi de Londres et de la Chambre. Bien, tout ça… Très correct, de bonne tenue, very british.
Pourtant, avec cet immense personnage que fut Winston Churchill, et avec ce point de basculement de la guerre (quelques semaines plus tard, après la bataille d’Angleterre, W.C. dira dans son style éclatant : « Ce n’est pas la fin. Ce n’est même pas le commencement de la fin. Mais, c’est peut-être la fin du commencement. »), on aurait pu, on aurait dû faire beaucoup mieux. A aucun moment au cours du film, je n’ai éprouvé ce sentiment d’urgence ni cette pression énorme que devait ressentir Churchill devant la décision à prendre, alors que les 300.000 soldats de Sa Majesté bloqués à Dunkerque pouvaient être faits prisonniers incessamment, et laisser l’Angleterre à la merci d’une invasion allemande. Le film ne m’a montré ni les conséquences possibles d’une décision contraire, ni le côté visionnaire de Churchill, qui voulait tenir le temps qu’il faudrait pour que l’Amérique se décide à entrer en guerre. Si vous voulez éprouver ces sentiments, vision de l’avenir, urgence, pression, lisez les Mémoires de Guerre de Churchill, ou même seulement sa biographie par François Kersaudy.
La dernière réplique du film mérite qu’on s’y arrête. C’est celle Lord Halifax, qui s’est opposé à W.C. pendant tout le film. Churchill vient de prononcer le fameux discours et la Chambre, hésitante au début, bascule dans l’approbation de la guerre et l’ovation de l’orateur. Le voisin de siège d’Halifax, ébahi, lui demande « Mais, qu’est-ce qui s’est passé ? » Lord Halifax lui répond :
—He mobilized the English language and sent it into battle.
—Il a mobilisé la langue anglaise et l’a envoyée au combat
Belle phrase — dont le véritable auteur est Edward Burrow , journaliste américain — qui résume bien ce que le film a voulu montrer sans tout à fait y parvenir.
Post scriptum
Puisque c’est le sujet, je ne résiste pas au plaisir de vous reproduire ici ce qu’a dit Vialatte de l’éloquence de W.C. :
« (…) Churchill disait encore : « Nous ne fléchirons ni ne faillirons. Nous nous battrons dans les rues, dans les champs, nous nous battrons sur les collines et sur les grèves. » Il ajoutait en aparté, bouchant le micro : « A coups de bouteilles ; car nous n’avons guère autre chose. » De tels discours relèvent de la ténacité. A cette échelle, elle sauve le monde. (…) »
Un autre témoignage dont l’auteur m’est inconnu :
« It has been said that Hitler could persuade you that he could do anything but that Churchill could persuade you that you could do anything. »
« On a dit qu’Hitler pouvait vous persuader qu’il pouvait tout faire mais que Churchill pouvait vous persuader que vous pouviez tout faire. «
ET DEMAIN, UN TEXTE DE MARIE-CLAIRE, LETTRE D’ELISABETH A SOPHIE
 Il fait chaud. Pour Elio, entre les baignades à la rivière, les filles, les déjeuners de famille sous la treille, les siestes et les exercices au piano, l’été s’écoule lentement, paresseusement, lascivement.Mais, bientôt, arrive le pensionnaire de cet été. Ce sera Oliver, un universitaire américain d’une trentaine d’années, grand, blond et sûr de lui.
Il fait chaud. Pour Elio, entre les baignades à la rivière, les filles, les déjeuners de famille sous la treille, les siestes et les exercices au piano, l’été s’écoule lentement, paresseusement, lascivement.Mais, bientôt, arrive le pensionnaire de cet été. Ce sera Oliver, un universitaire américain d’une trentaine d’années, grand, blond et sûr de lui. Dernière heure : SAMEDI 3 MARS
Dernière heure : SAMEDI 3 MARS
 Pendant ces quatre semaines cruciales, le film nous montrera les colères, les cigares, les hésitations, les cognacs, les doutes, les combats de Churchill pour amener son pays à abandonner toute idée de négociation et, malgré l’encerclement de son armée à Dunkerque, à entrer de toutes ses forces dans la guerre.
Pendant ces quatre semaines cruciales, le film nous montrera les colères, les cigares, les hésitations, les cognacs, les doutes, les combats de Churchill pour amener son pays à abandonner toute idée de négociation et, malgré l’encerclement de son armée à Dunkerque, à entrer de toutes ses forces dans la guerre.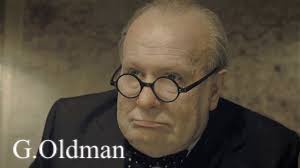 Pour ce qui est du film, j’ai vu une excellente performance de Gary Oldman, qui s’est composé un physique frappant de ressemblance, et une élocution étonnamment hésitante, dont j’ose croire qu’elle est fidèle à la réalité. Très bonne Kristin Scott-Thomas également, toute en distinction et humour britannique, bonne reconstitution aussi de Londres et de la Chambre. Bien, tout ça… Très correct, de bonne tenue, very british.
Pour ce qui est du film, j’ai vu une excellente performance de Gary Oldman, qui s’est composé un physique frappant de ressemblance, et une élocution étonnamment hésitante, dont j’ose croire qu’elle est fidèle à la réalité. Très bonne Kristin Scott-Thomas également, toute en distinction et humour britannique, bonne reconstitution aussi de Londres et de la Chambre. Bien, tout ça… Très correct, de bonne tenue, very british.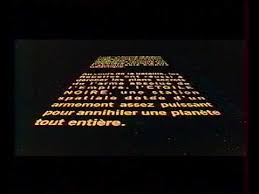 calme puis se tait tandis que l’œil descend vers un croiseur impérial menaçant de silence, ou un chasseur de la Résistance hurlant sa vitesse, ou une planète bleue vivant sans doute ses derniers instants…
calme puis se tait tandis que l’œil descend vers un croiseur impérial menaçant de silence, ou un chasseur de la Résistance hurlant sa vitesse, ou une planète bleue vivant sans doute ses derniers instants… Dupontel, mais, comme acteur, qu’est-ce qu’il est doué. Sa folie l’a amené parfois un peu loin dans le lourd : Neuf mois ferme. Mais on ne lui en a pas voulu, puisqu’il est fou, Dupontel.
Dupontel, mais, comme acteur, qu’est-ce qu’il est doué. Sa folie l’a amené parfois un peu loin dans le lourd : Neuf mois ferme. Mais on ne lui en a pas voulu, puisqu’il est fou, Dupontel.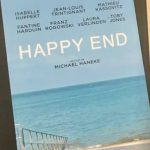 Le sujet est banal : une famille bourgeoise de Calais, les Laurent, très riches, très bourgeois, très province.
Le sujet est banal : une famille bourgeoise de Calais, les Laurent, très riches, très bourgeois, très province.