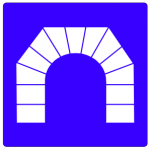 (…) L’homme ne prête pas attention à Bernard, il regarde devant lui, les yeux dans le vague. Bernard hésite et se lance :
(…) L’homme ne prête pas attention à Bernard, il regarde devant lui, les yeux dans le vague. Bernard hésite et se lance :
« Excusez-moi, monsieur, mais votre ami m’a dit que …
— Non, dit l’homme.
— Pardon ?
— Boutros ne vous a rien dit. Il ne parle pas votre langue. Mais j’ai entendu votre question.
— Alors ? Vous pouvez me dire où vous allez en Italie ?
— Non et non, dit l’homme, impénétrable. »
L’air idiot, Bernard ne peut que répéter cette réponse qu’il n’a pas comprise :
« Non et non ?
— C’est cela, dit l’homme au sac avec une toute petite étincelle de gaité dans le regard, non, je ne peux pas vous dire où nous allons et non, ce n’est pas en Italie.
— Vous n’allez pas vers l’Italie ? insiste Bernard qui, tout à son problème, n’a rien vu de l’étincelle.
— Puisque nous y sommes, dit l’homme de plus en plus énigmatique.
— On est en Italie ?
— Je le crains. Vous auriez préféré autre chose ? »
Le ton mondain que vient d’utiliser son interlocuteur vient de faire comprendre à Bernard que le bonhomme veut s’amuser. Énervé, il élève la voix :
« Écoutez, monsieur. Je suis fatigué, je suis épuisé, je n’en peux plus. Je viens de vivre les pires heures de ma vie. On s’est moqué de moi, on m’a tapé dessus. J’ai tué un homme. C’était lui ou moi, mais je l’ai tué. La police me poursuit depuis des heures, j’ai parcouru des kilomètres de tunnels pleins de rats. Je me suis cogné partout, je suis tombé un million de fois ; j’ai froid, j’ai faim, j’ai mal partout, j’ai perdu ma valise et mes chaussures, je vais perdre mon boulot et ma femme est une connasse. Mon patron aussi… enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et vous, vous jouez les mystérieux et vous vous foutez de moi depuis un quart d’heure… Alors je vous dis que j’en ai marre, marre, plus que marre… »
Bouleversé par sa propre tirade, Bernard se met à pleurer et c’est secoué de sanglots qu’il poursuit :
« Je sais pas où je vais, je sais pas où je suis, et je vous demande juste de me… et vous… vous… vous me… j’en ai marre, je veux mourir… laissez-moi tranquille, laissez-moi crever, foutez-moi la paix… une bonne fois… la paix…»
L’homme s’est levé de son sac. Il est venu s’agenouiller devant Bernard et lui a posé une main sur l’épaule. Il reste ainsi quelques instants à le regarder, silencieux.
« Je suis désolé, dit-il tandis que les sanglots de Bernard s’espacent. Je n’aurais pas dû… Je vous prie de m’excuser… Allons, allons… ça va aller… arrêtez de pleurer… s’il vous plaît, arrêtez de pleurer… regardez-moi… ça va aller… regardez-moi… s’il vous plait…
— Comment voulez-vous que ça aille mieux ? gémit Bernard en levant les yeux. J’ai tué un homme. Il n’y a pas pire, non ? J’ai tué un homme et la police me cherche. Ils savent que c’est moi, ils ont mes papiers, ils savent où j’habite… et vous me dites que ça va aller ! Non, ça ne va pas aller… je suis fichu, c’est fini, je suis fichu…
— Peut-être que si vous me racontiez, ça vous ferait du bien…
— C’est bien trop compliqué… bien trop long…
— Nous ne repartons que dans une heure. En une heure, on a le temps de dire beaucoup de choses, vous verrez.
— Vous croyez ? demande Bernard sur un ton hésitant, presque convaincu.
— Non, dit l’homme, je le sais. »
Et Bernard raconte. Il raconte le départ en retard pour Turin, les embouteillages, la neige qui tombe, le semi-remorque qui double, la voiture qui dérape. Il raconte la traversée de l’avalanche, les routiers qui rigolent, le camion qui s’appelle Gisèle, la bagarre dans la cabine, la mort du routier. Il raconte la fuite affolée dans le tunnel, la lampe qui s’éteint, la panique dans le noir et puis l’ultime échelle avec le guide tout en haut. Il raconte sa carrière hésitante au Bricorama de Villeurbanne, ses espoirs lors de son entrée chez SAUTI, sa femme, Gisèle, avec ses exigences et ses reproches, son patron, Sergio, le fils à papa Casagrande, avec sa Porsche, ses costumes Armani, sa fausse jovialité et ses réunions pour rien. Il raconte ses déceptions, sa fatigue, son désespoir, sa peur… Tout craque en lui, il lâche tout devant cet inconnu qui le regarde intensément et qui l’écoute. C’est la première fois qu’il parle à quelqu’un de sa femme insatisfaite, de son ménage bancal, de son play-boy de patron, de son métier stupide. Il découvre sur lui des choses qu’il ignorait avant de les énoncer. Il a l’impression de raconter une vie qui ne serait pas la sienne, d’analyser la personnalité de quelqu’un qui ne serait pas lui. Pour la première fois de sa vie, il explique ses échecs non par de malheureuses circonstances mais par ses propres faiblesses.
Il a parlé doucement, longtemps, sans pause, sans pathos, d’une voix neutre, et puis il s’est tu. Il venait de dresser un constat de sa vie et pour la première fois, il réalisait qu’il n’était pas heureux. Depuis qu’il avait eu seize ans, il ne l’avait jamais été ; il s’en rendait compte à présent, jamais il n’avait vraiment décidé quelque chose, jamais il n’avait affronté personne. Pour lui, tout n’avait été que facilité, faiblesse, pente douce, évitement, résignation. Et voilà où il en était. Sa vie était une erreur, un ratage, un échec total. Mais voilà, c’était fait. Il avait envie de mourir.
« Alors, dit l’homme, ça va mieux maintenant ?
— J’ai envie de mourir…
— Pourquoi ? Parce que vous avez raté la première partie de votre vie ? Quel âge avez-vous ? Trente-six, trente-sept ans ? Mais il est encore temps d’en commencer une autre ! Vous avez cette chance : encore du temps devant vous. Vous pouvez tout changer, recommencer…
— Mais j’ai tué quelqu’un ! crie Bernard. On ne peut pas recommencer sa vie quand on a tué quelqu’un ! »
A l’autre bout de la pièce, le guide s’agite et gronde :
« Vous n’allez pas la fermer un peu, là-bas ? Je vous préviens : on repart dans une demi-heure alors, vous feriez bien de dormir, sacré bonsoir ! »
Bernard répète en chuchotant :
« On ne peut pas recommencer sa vie quand on a tué quelqu’un…
A SUIVRE