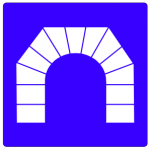 (…) Il se penche dans la voiture pour attraper son téléphone — douleur — il s’extrait de l’habitacle avec prudence, claque la portière avant, ouvre la portière arrière — douleur — attrape d’une main son manteau — douleur — enfile le bras valide dans une manche, puis l’autre bras — douleur, douleur — claque la portière arrière en la poussant avec la hanche, va au coffre, l’ouvre, en sort sa valise à roulette de la main gauche et referme le coffre en le claquant dans un grand mouvement du bras droit. Aïe ! Il avait oublié — douleur, douleur, douleur !
(…) Il se penche dans la voiture pour attraper son téléphone — douleur — il s’extrait de l’habitacle avec prudence, claque la portière avant, ouvre la portière arrière — douleur — attrape d’une main son manteau — douleur — enfile le bras valide dans une manche, puis l’autre bras — douleur, douleur — claque la portière arrière en la poussant avec la hanche, va au coffre, l’ouvre, en sort sa valise à roulette de la main gauche et referme le coffre en le claquant dans un grand mouvement du bras droit. Aïe ! Il avait oublié — douleur, douleur, douleur !
…la vache ! qu’est-ce que ça fait mal ! j’ai vraiment dû me casser quelque chose… merde, les clés ! j’ai oublié les clés à l’intérieur !…
Il retourne à l’avant, ouvre la portière de la main gauche, se penche à l’intérieur pour tenter d’atteindre les clés, impossible sans entrer dans la voiture, se résigne à s’asseoir au volant, tend le bras vers les clés — douleur — les attrape et s’extrait finalement de l’habitacle sans trop de peine. Il est en nage, il est essoufflé, il a mal au bras ; sous la veste et le manteau, la transpiration plaque sa chemise glacée contre sa poitrine. Il s’appuie contre la voiture. Il voudrait se laisser glisser au sol, s’asseoir par terre, dans la neige. Il voudrait que quelqu’un vienne, qu’on lui parle gentiment, qu’on lui apporte un café chaud, une couverture, qu’on lui dise que tout va s’arranger, que tout va aller bien…
« Eh alors ! Ça vient, oui ? »
…allons bon, voilà l’autre brute qui s’impatiente !…
« J’arrive ! J’arrive ! »
…fais chier, mec ! t’as pas mal au bras, toi !…
« J’arrive ! J’arrive ! »
Quand il a rejoint le routier, l’homme a grommelé quelque chose comme « C’est pas trop tôt », et sans dire un mot de plus, il lui a tourné le dos et l’a entrainé vers un endroit du mur de neige qu’il avait dû repérer un peu plus tôt. La coulée y avait formé une sorte de pente douce qui permettait de grimper sur la masse de neige sans trop de difficulté. La traversée de l’avalanche pouvait commencer.
Ce fût un calvaire. On aurait dit que le sol avait été labouré par un géant fou. À chaque nouveau pas, Bernard se demandait s’il allait s’enfoncer dans une couche de poudreuse, buter contre un bloc de glace ou se prendre les pieds dans une branche de sapin déraciné. Au bout de quelques minutes, ses mocassins détrempés avaient perdu toute rigidité, son corps était frigorifié des pieds à la ceinture et il ruisselait d’une transpiration glacée de la racine des cheveux jusqu’au creux des reins. Il trainait derrière lui sa Samsonite de cadre moyen dans le vent. C’était Gisèle qui la lui avait offerte en des temps plus prometteurs : « Puisque maintenant tu vas voyager pour ton travail, il te faut une valise chic, Bernard, une valise à roulettes, quelque chose d’élégant… ». Pour le moment les roulettes de la Samsonite lui paraissaient bien futiles car à tout instant, la petite valise se laissait aller sur la neige dans la première pente venue. De temps en temps, elle venait même se glisser entre ses jambes et le faisait tomber lourdement au fond d’une cuvette de neige molle ou sur un éboulis dur comme du béton.
… fais chier, Gisèle, avec ta valise à la con ! T’aurais mieux fait de m’acheter un sac à dos !…
Il fallait absolument qu’il reste à proximité de la brute qui le précédait pour pouvoir profiter de la faible lumière de sa lampe. Alors, il se relevait le plus vite possible, retombant parfois sur son bras douloureux, emplissant l’échancrure de son manteau de neige fraiche, le souffle de plus en plus court, la sueur glacée de plus en plus poisseuse sous sa chemise. Il maudissait Gisèle qui l’avait mis en retard, il maudissait son patron et ses réunions qui ne servaient à rien, sa valise qui se prenait dans ses jambes, la neige qui n’arrêtait pas de tomber, sa voiture, pas fichue de tenir la route dès que ça glissait un peu, les camionneurs — des voyous ceux-là — mais surtout, il maudissait son guide qui le menait à un train d’enfer.
Et puis, à un moment, les choses avaient paru s’arranger. C’était depuis qu’il avait décidé d’appeler le routier “Gustave“. Gustave ! Il ne savait ni quand ni pourquoi, mais ça lui était venu comme ça, sans réfléchir. Peut-être parce qu’il avait toujours trouvé ce prénom ridicule, hostile même. Pourtant, il ne connaissait aucun Gustave, il ne se souvenait d’aucun professeur détesté ni d’aucun camarade de classe tyrannique qui se soit prénommé Gustave. Mais sur l’instant, ce nom matérialisait très bien tout le mal qu’il pensait de ce gros costaud, ce gros con avec son gros camion, son gros anorak et ses grosses chaussures. Tout en le suivant péniblement dans la neige, courbé en avant, tête baissée, col relevé, alors qu’il achevait de lui adresser silencieusement une première salve d’injures et de malédictions : « sale type, pauvre mec, jeune crétin, ignare, poids-lourds de mes deux, ça te ferait mal de ralentir un peu, gros con… », il avait ajouté « Vas-donc, hé, Gustave ! » comme si le prénom lui-même était une insulte, et ça l’avait fait éclaté de rire. L’autre s’était retourné, l’éblouissant avec sa lampe :
« Quoi encore ? Qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi vous rigolez ?
— Mais je ne rigole pas, je tousse. On a le droit de tousser quand même ! Dites, vous ne pourriez pas ralentir un peu, s’il vous plait ? Je me suis fait très mal au bras tout à l’heure…
— On n’a pas le temps. Faut se grouiller ! Et puis, mal au bras, ça empêche pas de marcher, je présume… »
Et Gustave avait repris sa marche inexorable vers les lumières de la station.
…Gustave, gros con ! gros con ! gros con !…
Bernard le suivait en ricanant et ça lui faisait du bien.
A SUIVRE