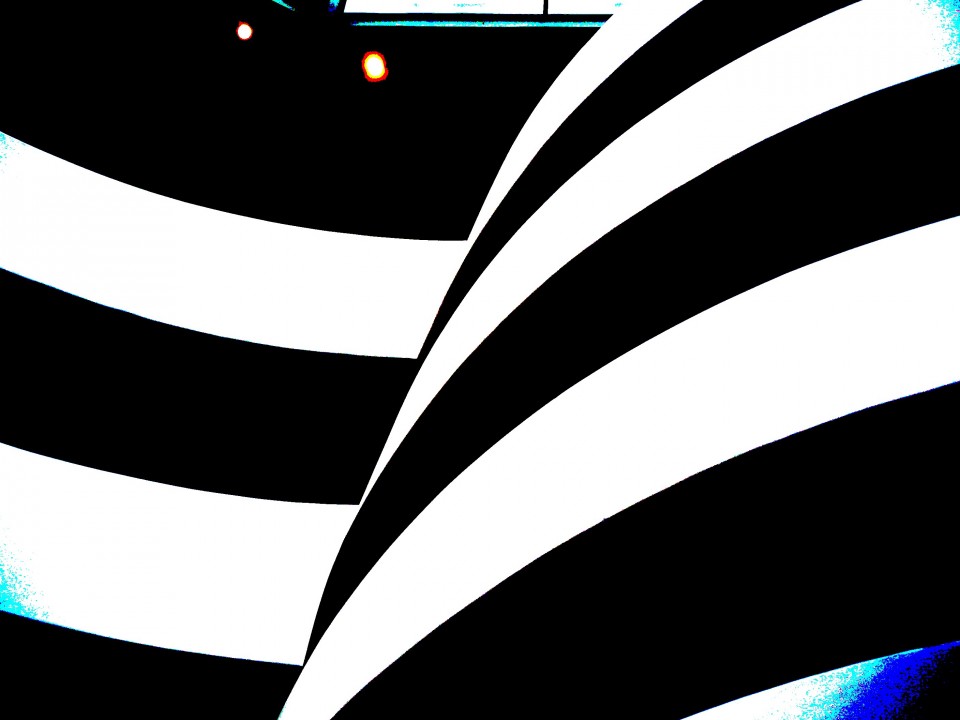Deux intellectuels assis vont moins loin qu’une brute qui marche.
Michel Audiard. Un Taxi pour Tobrouk
Archives mensuelles : octobre 2014
Tourisme
Fallait pas !
Vers le début des années 2000, je me mis à chasser de moins en moins car mon nouveau chien n’y trouvait aucun intérêt. Deux ou trois fois par an, j’étais encore invité par un ami pour chasser dans sa propriété du côté de Compiègne. Ces journées là étaient agréables. Faisans, canards, gibier d’élevage, mais abondant et volant haut, invités bien élevés, parisiens ou campagnards, bonne ambiance, bonne table. À part les pigeons que nous tirions au passage et les lapins de garenne que nous chassions parfois au furet, le seul gibier vraiment sauvage dans cette chasse consistait en une douzaine de chevreuils qui vivaient sur place. Chaque année le nombre de bracelets, c’est à dire de bêtes que nous avions le droit de tuer, était de six à huit.
Comme je l’ai dit ailleurs, j’ai beaucoup aimé la chasse, et je l’aime encore aujourd’hui, mais de façon platonique puisque je ne la pratique plus. Pourtant, au cours de toutes mes années de chasse, je n’ai jamais aimé tirer les chevreuils et je me suis toujours évertué à me trouver, pour moi et pour les autres, une excuse valable pour m’abstenir de faire feu: je n’étais pas en bonne position, le coup de fusil eut été dangereux, je n’étais pas chargé, ou avec un plomb trop petit, l’animal m’avait paru trop jeune ou je ne l’avais tout simplement pas vu. Quand l’excuse risquait de n’être pas recevable, je me débrouillais pour tirer au dessus ou derrière le chevreuil en fuite. Bref, en plus de quarante ans de chasse, j’ai réussi à n’en pas tuer un seul.
Cela ne m’empêchait pas d’accepter ma part de gibier, y compris la pièce de chevreuil à laquelle ma participation à la journée donnait droit. La refuser, ce dont je n’avais d’ailleurs pas la moindre envie, eut été impoli.
Durant cette période, nous avions pour voisins de campagne Paul et Sylvie, un jeune couple dont chacun avait travaillé pour Walt Disney à faire des dessins anthropomorphiques de petits et de grands animaux doués de parole, d’intelligence et de sentiments. Nous étions devenus amis avec ces jeunes gens, si différents de ce que nous connaissions: un peu artistes, beaucoup bohèmes, pas mal buveurs, passionnément fumeurs, à la folie indépendants. Cette année là, ils étaient dans une passe difficile, licenciés tous les deux. Pour d’obscures raisons, un seul des deux avait alors droit au chômage. Nous les invitions souvent à diner, ou bien nous nous invitions chez eux en nous chargeant d’apporter viandes et boissons. Les dîners étaient toujours intéressants et plutôt joyeux, et nous respections mutuellement nos grandes différences de point de vue.
Un beau jour, comme il était prévu que nous devions diner chez eux le lendemain soir, j’apportai, bien emballé dans un papier kraft, un superbe cuissot de chevreuil qui me venait de ma dernière chasse. Quand j’entrai dans la grande cuisine, la maitresse de maison était occupée dans la pièce voisine à dessiner un petit écureuil à casque et scooter.
-Entre, Philippe, entre. Je termine juste un truc et j’arrive. Sers-toi un verre en attendant. Il y a du vin ouvert sur la table.
-Je t’ai apporté le diner de demain soir.
-C’est gentil. Fallait pas…
Je posai la viande sur la table. Nous continuâmes la conversation sur le même ton d’une pièce à l’autre. Quelques instant plus tard, Sylvie entra dans la cuisine, m’embrassa sur la joue et se servit un verre de vin. Puis elle regarda le paquet sur la table :
-Qu’est-ce que tu nous a apporté encore…Fallait pas…
Lorsqu’elle déchira le papier kraft, qu’elle vit le petit sabot noir et brillant, le pelage brun clair et la plaie encore sanguinolente du découpage de la cuisse, elle poussa un petit cri puis resta un instant stupéfaite. Puis elle me regarda et je compris que j’avais tué et découpé Bambi.
C’est vrai, fallait pas !
Les grands classiques
Voici un poème en vers libres.
Ils sont libres parce que je les ai libérés de la prison dans laquelle ils vieillissaient au plus profond de ma mémoire sans avoir vu le jour depuis mon baccalauréat.
Patchwork
Je suis venu calme orphelin
Vers les hommes des grandes villes
Rappelle-toi, Barbara,
Il pleuvait sans cesse sur Brest.
Un soir, t’en souvient-il ? Nous voguions en silence ;
Les nuages couraient sur la lune enflammée
Comme sur l’incendie on voit fuir la fumée.
Du palais d’un jeune Lapin
Dame Belette un beau matin
S’empara ; c’est une rusée.
N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie !
Avec le temps,
Avec le temps, va, tout s’en va
Poète prends ton luth:
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure.
Mes chers amis, quand je mourrai,
Plantez un saule au cimetière.
Passe encore de bâtir, mais planter à cet âge !
Ca demande des mois d’turbin,
C’est une vie de galérien,
Jugeant la vie amère
Et voulant se donner quelque distraction,
Il servit à son père une décoction
Je me les sers moi-même, avec assez de verve
Mais je ne permets pas qu’un autre me les serve.
Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres
Et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux
Si tu reviens jamais danser chez Temporel
Un jour ou l’autre
Oui je viens dans son temple adorer l’Eternel
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague
Tout suffocant
Et blême quand
Sonne l’heure,
Je suis chevau-léger de la maison du Roi !
Plus vague et plus soluble dans l’air
Le temps ne fait rien à l’affaire,
Quand on est con, on est con.
Mais quand j’sors avec Hildegarde,
C’est toujours moi qu’on r’garde.
La fille de Minos et de Pasiphaé
Quand je pense à Fernande
C’est Vénus toute entière à sa proie attachée !
En chemise, madame Phèdre
Fait des mines de sapajou.
Comme je descendais des fleuves impassibles
C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit
J’étais seul l’autre soir au Théâtre Français
A voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on laisse
Seul le silence est grand ; tout le reste est faiblesse.
Des lambeaux pleins de sang et des membres affreux
Que des chiens dévorants se disputaient entre eux.
Ce sont les cadets de Gascogne
De Carbon de Castel-Jaloux ;
On dirait le Sud,
Le temps dure longtemps
Frères humains qui après nous vivez
Vivez si m’en croyez, n’attendez à demain.
Vivre entre ses parents le reste de son âge.
J’ai vingt-six ans, mon vieux Corneille,
Et je t’emmerde en attendant.
Bon appétit, messieurs !
Adieu, veau, vache, cochon, couvée !
Vous avez surement reconnus les auteurs de ces classiques. S’il vous en manque un ou deux, lisez la suite… Continuer la lecture de Les grands classiques
Collage 47
Collage papier (13×20,5cm) de Sébastien Coutheillas
Pour en voir d’autres, cliquez ici
Les paroles s’envolent
Tout ce qui n’est pas écrit disparait.
James Salter
Au Café de Flore (Couleur café n°11)
Au Café de Flore (Boulevard Saint Germain, Paris)
Couleur café n°11
C’est la fin du mois de mars. Il fait beau et frais. Il est un peu plus de neuf heures et demie et je n’ai rien de spécial à faire dans les deux heures qui viennent. C’est le moment de me rendre dans un bistrot pour tenter de compléter ma série des « Couleur café ». Je prends un Vélib et, sans donner un seul coup de pédale ni rencontrer un seul feu rouge, je descends la rue Soufflot puis la rue de Médicis. La pente de la rue Garancière m’expédie dans un virage risqué jusqu’à l’entrée de la place Saint Sulpice. La beauté du paysage qui défile, l’inclinaison que je prends dans les courbes, le bruit du vent dans mes oreilles, le froid sur mes joues, tout ça me fait penser aux premières descentes à ski des matins de Tignes et c’est presque Continuer la lecture de Au Café de Flore (Couleur café n°11)
Guggenheim
Bill Murray -6-
I ordered a chicken and an egg from Amazon. I’ll let you know.
J’ai commandé un poulet et un oeuf sur Amazon. Je vous tiendrai au courant.
Maestro (Critique aisée 38)
Ça fait snob, c’est certain. Mais je dois à la vérité de dire que je viens de voir Maestro depuis le siège 24F du vol AF 0012. Ce ne sont assurément pas les meilleures conditions pour voir un film. Mais sans cela, sans ces sept heures de vol à ne rien faire d’autre qu’à se demander quand ils vont servir le champagne, lire les articles de tourisme chic de la revue Air France, essayer de me protéger le crâne du soufflement inextinguible de l’air conditionné, regarder du coin de l’œil les écrans des autres passagers et surveiller le bruit des réacteurs, Continuer la lecture de Maestro (Critique aisée 38)